Train de la mort : convoi 7909 pour Dachau le 2 juillet 1944
Train de la mort : convoi 7909 pour Dachau le 2 juillet 1944
Le camp de Dachau où fut déporté monsieur Pierre Colognac, ainsi que des milliers d'hommes.
De 1942 à 1944, le camp de Royallieu fut le point de départ de plus de 50 convois de milliers de prisonniers à destination des camps de concentration de Auschwitz, Buchenwald, Mauthausen, Sachsenhausen, Ravensbrück, Dachau, et bien d’autres encore.
Compiègne
Le 1 juillet 1944, à 9 h 40, sur les voies 4 et 6 de la gare de Compiègne, le train 7909 est constitué à partir de 37 éléments, dont 22 wagons type « hommes 40, chevaux en long 8 ».
Wagons
Autrement dit, des wagons dimensionnés chacun soit pour le transport de 40 hommes, soit pour le transport de 8 chevaux en long.
Convoi
C’est le plus important convoi de déportés jamais constitué au départ de Compiègne. Sa destination est le camp de concentration de Dachau.
Matin
Au matin du 2 juillet 1944 à 6 h précise. Un long convoi de 2166 détenus, fortement encadré, quitte le camp pour se rendre à la gare de Compiègne, distante de plusieurs kilomètres, et être embarqué à bord du train 7909 à destination de Dachau.
Entassés
Les hommes sont entassés à 100 par wagon, voire plus parfois, et peuvent seulement se tenir debout. Ils sont à peine pourvus d’une boule de pain noir et d’un peu de saucisson, tout cela pour un voyage de 4 jours.
Paille
Le plancher est recouvert d’un peu de paille sur laquelle on a répandu de la chaux, une tinette est installée dans un coin et un tonneau d’eau à peine à moitié rempli est à disposition dans chaque wagon.
Lucarne
De chaque côté, une petite lucarne grillagée de 50 centimètres sur 25 sera la seule source d’aération.
Conditions
Le convoi errera 3 jours dans des conditions abominables de chaleur et d’absence de ravitaillement, particulièrement durant la première journée du 2 juillet 1944.
Wagons
Certains wagons arrivent à organiser et maintenir une certaine discipline et auront peu de victimes. Dans d’autres wagons, transformés en étuves, la tension monte peu à peu, à la limite de l’explosion hystérique collective.
Folie
Les hommes échappent à tout contrôle, s’entretuent, la folie est là. Certains wagons deviennent ainsi progressivement de vrais charniers, où l’on meurt de chaleur, de manque d’eau, d’asphyxie, ou bien sous les coups de son voisin qui lutte pour sa propre survie.
Situation
Au moment où la situation était intenable, et malgré les appels de détresse des détenus, les soldats gardiens allemands ont refusé d’ouvrir les portes des wagons pour les aérer et ont refusé de distribuer l’eau qui aurait sauvé les mourants.
Ravitaillement
Le peu de ravitaillement concédé la soirée du 3 juillet et la journée du 4 juillet arrivera trop tard.
Le procès du "Train de la mort" au tribunal militaire de Metz se déroula en février 1950. Un train tristement célèbre en raison du nombre de déportés décédés durant le trajet. Photo Archives RL
Arrivée
Arrivée a de Dachau le 5 juillet 1944, les corps sans vie sont retirés des wagons, sans être enregistrés. 536 cadavres, 984 selon d’autres estimations, prennent la direction du four crématoire du camp de Dachau, qu’ils alimenteront 4 jours durant.
Bilan
Selon la discipline qui a pu être maintenue ou selon le degré de panique qui a gagné les détenus, le bilan par wagon est tragique : 1 wagon compte 99 morts, 3 wagons comptent 75 à 76 morts chacun, seulement 9 wagons sur les 22 au départ ne compteront aucun mort.
Exterminés
Près de 900 jeunes hommes, dans la force de l’âge, entre 18 et 25 ans, ont été exterminés en cette seule journée du 2 juillet 1944.
Survivants
Les survivants ont été ensuite acheminés vers le camp de concentration de Dachau et ses kommandos, d’où certains ne reviendront jamais, épuisés par le travail, la maladie ou les mauvais traitements.
Le train de la mort, de Christian BERNADAC (Auteur) 1 janvier 1970.
Nomination
Après la nomination d’Adolf Hitler au poste de chancelier, le 30 janvier 1933, les nationaux-socialistes instaurent en quelques semaines, grâce à la terreur, une dictature dans le Reich allemand.
Persécution
La persécution et l´élimination de l’opposition politique en constituent le volet central. Afin d´emprisonner en masse les opposants politiques, des camps de concentration sont ouverts sur tout le territoire du Reich.
Camp
Le camp de concentration de Dachau est l´un d´eux. Le 22 mars 1933, les premiers convois de prisonniers atteignent le camp, érigé sur l’emplacement d’une usine de poudre et de munitions désaffectée.
Theodor Eicke
Le commandant du camp, Theodor Eicke, instaure en octobre 1933 une charte de camp qui prévoit un ensemble de punitions brutales pour les détenus et des directives pour les SS (Schutzstaffel) du camp.
Règles
Cet ensemble de règles institutionnalise la domination des SS sur les prisonniers, domination marquée par l´arbitraire et la terreur.
Histoire
L’histoire du camp (1933 - 1945), Dachau est le symbole des crimes contre l’Humanité de l’univers concentrationnaire, au même titre que le camp d’extermination d’Auschwitz rappelle le génocide du peuple juif.
Premier
Dachau fut le premier camp de concentration d’Etat du Reich, créé par Hitler le 22 mars 1933, un mois seulement après son élection comme chancelier.
Libéré
Il fut aussi l’avant-dernier camp libéré par les Américains, le 29 avril 1945, la veille de la mort d’Hitler.
Publicité
Dachau connut d’emblée une publicité extraordinaire, la presse quotidienne rendant compte des nouveaux convois de détenus, arrêtés par la police bavaroise puis gérés par la SS, ces deux organismes ayant comme chef le même homme : Heinrich Himmler.
Référence
Le camp devint la référence, le modèle, l’école du crime SS, formant à « l’École de la Violence » les futurs cadres et gardiens SS des camps et servit de prototype pour les 1650 camps ultérieurs (infrastructure, organisation, fonctionnement).
Répression
Dachau fut d’abord un camp de répression destiné aux opposants politiques allemands au régime nazi (communistes, sociaux-démocrates) en vue de leur « rééducation » et de leur réinsertion dans la nouvelle société totalitaire.
Maximes
Une des « maximes éducatives », « Arbeit macht frei » (le travail rend libre.), est inscrite sur son portail d’entrée.
Présenté
Le camp était alors présenté comme un moyen de protéger la population des opposants placés provisoirement hors de la « communauté du peuple » grâce à la procédure de Schutzhaft, la détention de sécurité sans jugement.
Enfermés
Y furent rapidement enfermés tous ceux considérés par Hitler comme « superflus, nocifs ou en surnombre », et parmi eux des Juifs, des soi-disant « asociaux », des Tsiganes assimilés à ces derniers, des Témoins de Jéhovah, on y compta 2 771 religieux, hostiles au nazisme, dont 700 moururent et 300 disparurent.
Population
Dachau, conçu pour 5 000 détenus, avait une population permanente de 35 000 détenus dans des conditions particulièrement dégradantes.
Croissance
À partir de 1939, le camp connut une forte croissance du nombre des déportés, représentant 38 nationalités différentes. Les détenus du Reich devinrent minoritaires, avec moins de 10 % des effectifs.
Déportés
Le camp comptabilisa ainsi jusqu’à 40 000 déportés, répartis en 183 kommandos extérieurs, pouvant compter plusieurs milliers de détenus, épuisés par le travail et la faim, jusqu’à la mort.
Détenus
Il reçut plus de 200 000 détenus, dont 84 738 après-juin 1944 ; 41 500 y moururent, 160 000 autres victimes furent marquées à vie par les tortures, le travail forcé et l’avilissement.
Expérimentations
À Dachau furent expérimentées des méthodes d’extermination sur les enfants déficients, malades mentaux, vieillards, grabataires, dont les « médecins » furent ensuite mutés dans les camps d’extermination de juifs.
Expériences
200 détenus moururent d’expériences pseudo-médicales : injection de malaria et de tuberculose, hypoxie d’altitude, hypothermie dans l’eau glacée, produits coagulants causant des phlegmons…
Lieu
Dachau fut le lieu de pendaisons, d’assassinats de détenus d’exécutions systématiques, dont celles de 4 000 prisonniers de guerre soviétiques. Dachau enferma 583 homosexuels et plusieurs furent émasculés.
Cadavres
À la libération, 2 300 cadavres furent également découverts en gare de Dachau, dans un train arrivé de Buchenwald.
Corps
Les corps, jetés pêle-mêle, étaient brûlés dans des fours crématoires. Quand la mortalité dépassait les capacités des fours, les morts étaient jetés dans d’immenses fosses, comme celle de Leitenberg avec plus de 7 700 cadavres.
Épidémie
Une épidémie de typhus causa le décès de 17 342 détenus entre décembre 1944 et mai 1945 ; 2 200 détenus moururent encore en mai 1945, après la libération du camp.
Dès de lendemain de la libération du camp par les GI’s, des détenus de Dachau brandissent un drapeau américain. ©Usis-Dite / Leemage.
Témoignages
- Dachau fut le camp où, afin de conserver des preuves et de témoigner de la réalité des souffrances infligées, les détenus se regroupèrent et s’organisèrent avant même leur libération dans le Comité International des Détenus, devenu par la suite Comité international de Dachau (CID).
- Dachau fut filmé dès sa libération avec d’importants moyens cinématographiques qui authentifient l’horreur découverte. La possession de témoignages aussi importants de cette période historique, aussi sombre, soit-elle, constitue aujourd’hui un atout pour l’action mémorielle.
Procès
À Dachau, comme à Nürenberg pour les hauts responsables nazis, siégea un tribunal militaire américain, ayant comme preuves irréfutables les témoignages qu’apportèrent de nombreux anciens détenus.
Jugés
À Dachau, furent ainsi jugés et condamnés en 489 procès les responsables des camps de concentration « pour avoir, dans la poursuite d’un but collectif, perpétré les actes criminels suivants : atrocités, sévices corporels y compris homicides, bastonnades, tortures, mort par manque de nourriture, actes de violence et humiliations ».
Évacuation
Fin avril 1945 les SS commencent à évacuer des détenus du camp de Dachau. Afin d’éviter leur libération par les troupes alliées.
Prisonniers
Au moins 25 000 prisonniers du système concentrationnaire de Dachau sont forcés de marcher en direction du Tyrol ou évacués dans des trains de marchandise.
Détenus
Plusieurs milliers de détenus y perdent la vie. Le 29 avril 1945, des unités de l’US Army libèrent le camp de Dachau. Le jour même, les survivants fondent le comité international du camp de Dachau.
Épuisement
Pour des milliers de détenus, la libération arrive trop tard ils meurent d’épuisement, de maladies et des suites de leur déportation.
Soldats américains à l'entrée du camp de concentration de Dachau, Allemagne, 1945 source : National Archives Records of the Office of War / Wiki Commons.
Libération
Le 29 avril 1945, lorsque les hommes des 42e et 45e divisions américaines franchissent les grilles du camp de Dachau, sur lesquelles figure, forgée dans le fer, la sinistre formule « Arbeit macht frei » (« Le travail rend libre »), le fleuron du système concentrationnaire nazi, situé près de Munich, en Allemagne du sud, est en complète désintégration.
Fuite
Seuls, sont restés sur place quelques dizaines de SS, plus préoccupés de préparer leur fuite que de surveiller les déportés, terrés dans les 30 baraques du camp et terrorisés par la rumeur d’un grand massacre final au lance-flammes.
Les 1630 rescapés du train de la mort.
Spectacle
Le spectacle qui s’offre aux yeux des GI’s, déjà durement éprouvés par de violents combats au cours des semaines précédentes, est effroyable.
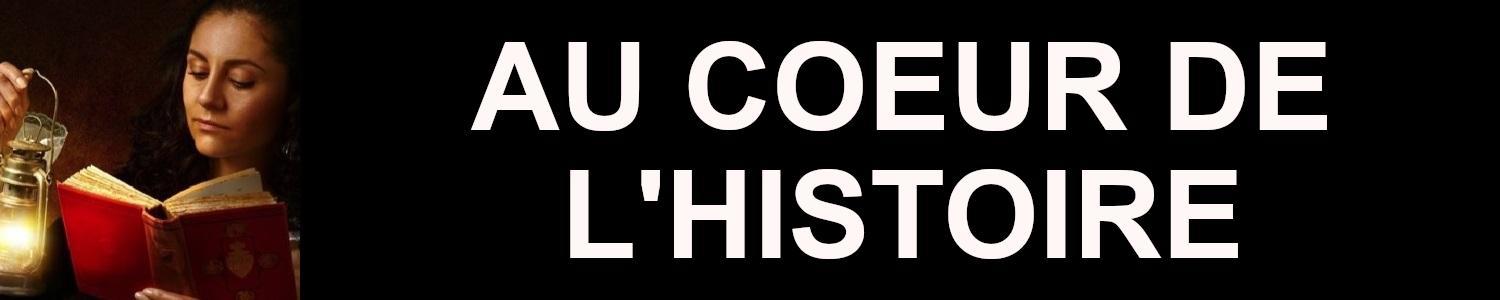
Commentaires
Enregistrer un commentaire