La naissance des maquis du Vercors
La naissance des maquis du Vercors
En juin 1944, Félix Forestier est envoyé depuis Paris pour filmer la résistance dans le maquis du Vercors : ses images n'ont été retrouvées qu'en 2013.
Le mouvement de résistance franc Tireur est à l’initiative de la création d’un premier maquis dans le massif du Vercors.
Massif
Ce massif se situe dans les Préalpes, sur les départements de l’Isère et de la Drôme. Il est couvert de forêts denses et son relief rend son accès et son contrôle difficiles.
Maquis
Le maquis du Vercors doit d’abord servir de refuge aux hommes traqués par la police de Vichy, mais il doit aussi être une tête de pont pour attaquer les Allemands par l’arrière.
Réserve
Combiné à un débarquement et à un parachutage, il doit devenir une réserve de troupes qui s’abattra sur l’ennemi, plutôt que d’être réduit au rang de simple forteresse : c’est le plan Montagnard.
Camps
Au début de l’année 1943, on compte déjà 9 camps de maquisards dans le Vercors, réunissant 500 membres environ.
Opposants
Ces camps abritent des jeunes hommes, qu’ils soient opposants politiques ou réfractaires au STO (Service du Travail Obligatoire).
Technique
Technique de la tête de pont : c'est une technique militaire servant principalement à mettre en place un périmètre à l'intérieur duquel l'armée pourra manœuvrer dans le but d'augmenter le territoire conquis, ou servira de point de repli si une défaite menace.
Maquisards
Les maquisards du Vercors accomplissent des actes de résistance courageux comme des sabotages dans les usines.
Déraillements
Ils procèdent à des déraillements de trains pour désorganiser le ravitaillement allemand et détruire leur matériel.
Reconnaissances
Ils organisent aussi des reconnaissances et des surveillances pour établir une carte des forces allemandes en présence.
Moyens
Les moyens des maquisards du Vercors sont néanmoins très réduits. Isolés, ils dépendent d’un ravitaillement très aléatoire en nourriture et en armes. Ils doivent surtout compter sur la sympathie des habitants qui les entourent.
Énergie
Malgré une énergie évidente et un premier grand parachutage d’armes au mois de novembre, ils peinent à s’organiser durant toute l’année 1943.
Sursaut
À partir du printemps 1944, les maquis du Vercors connaissent un sursaut. La rumeur d’un débarquement allié imminent amèneune remobilisation dans leurs rangs.
Volontaires
Après le 6 juin 1944, date du débarquement de Normandie, de nouveaux volontaires rejoignent le massif pour atteindre le chiffre de 4 000 membres.
Visibles
La France Libre demande néanmoins aux maquisards de ne pas se montrer trop visibles et enthousiastes, car les Alliés n’ont toujours pas envisagé un parachutage massif de renforts et d’armements sur leur zone.
Stratégie
La stratégie de la tête de pont n’est donc pas encore effective.
Yves Farge
Toutefois, la perspective d’une victoire semble évidente pour les maquisards ; en témoigne la déclaration du commissaire de la République Yves Farge qui déclare que la République française est restaurée dans le Vercors à partir du 3 juillet 1944.
Vichy
Les décrets de Vichy y sont abolis et toutes les lois de la République sont remises en vigueur.
République
Malgré la restauration de la République dans le Vercors, les Allemands ne comptent pas en finir aussi vite. Après une première offensive à Saint-Nizier au mois de juin 1944.
Attaquent
Ils attaquent massivement le maquis à partir du 21 juillet 1944 avec 15 000 soldats, faisant 800 morts, maquisards et civils confondus. Devant cette tragédie, les survivants tentent de fuir par petits groupes.
Allié
Aucun allié n’est parachuté sur le Vercors pour sauver les maquisards. Le massif est devenu une forteresse assiégée, peuplée de trop nombreux hommes faiblement armés et formés, le rapport de force ne bascule qu’à partir du 15 août 1944, quand a lieu le débarquement en Provence.
Le 27 juilliet 1946 cérémonie à la grotte de la Luire.
Hôpital
Dans la nuit du 21 au 22 juillet 1944, l’état-major du Vercors, devant l’aggravation de la situation, donne l’ordre de replier l’hôpital du Maquis, installé le 8 juin à Saint-Martin-en-Vercors, sur l’hôpital de Die.
Blessés
Un car, deux camions et une voiture particulière embarquent 122 blessés, les malades et le personnel. Par la route du col de Rousset, le convoi rejoint Die au petit matin, la mère supérieure de l’hôpital signale l’arrivée imminente des Allemands.
Danger
Devant ce danger, le docteur Ganimède décide de laisser quelques blessés légers à Die, de remonter sur le massif.
Luire
Conduit par Fabien Rey, à Saint-Agnan-en-Vercors, sous le porche d’entrée de la grotte de la Luire, dont le petit lit pierreux est très souvent à sec.
Drame
Le porche n’est pratiquement pas visible depuis la route départementale 518. La grotte, bien que déjà répertoriée dans des guides touristiques, n’est guère connue que des spéléologues et de quelques habitants du voisinage.
Refuge
Elle apparaît donc comme un refuge sûr. Cependant, le docteur Ganimède et le médecin-capitaine Fischer, inquiets, essaient d’évacuer les blessés les moins atteints, le soir du 22 juillet 1944, 50 blessés et 18 soignants quittent la grotte et rejoignent Romans.
Réfugier
Le 25 juillet 1944, le docteur Ganimède fait se réfugier, dans une cavité au-dessus du porche, un groupe de blessés qui peuvent se déplacer avec des béquilles. Ils sont accompagnés par deux infirmières, Lucie Jouve et Marie Roblès.
Grotte de la Luire Aujourd'hui.
Porche
Sous le porche de la grotte de la Luire il reste moins de la moitié du groupe : 45 blessés intransportables, dont une trentaine de maquisards, parmi lesquels on citera Juliette Lesage ( « Lilette » ), infirmière blessée au combat de Combovin le 22 juin 1944.
Officier
Un officier américain Chester Meyers, d’un commando parachuté le 29 juin 1944, opéré de l’appendicite.
Soldats
Et aussi quatre soldats allemands ou polonais, Félix Dombrowski, Kruzel, Malacowski et Veronecki, blessés capturés en juin au combat de Montclus et portant l’uniforme de la Wehrmacht.
Encadrement
Treize personnes constituent l’encadrement : trois médecins, les docteurs Fischer ( « Ferrier » ), 32 ans, médecin capitaine du Groupement des chantiers de jeunesse n° 19 qui avait rejoint la Résistance au Vercors, Marcel Uhlmann, 32 ans, (médecin juif, et Ganimède, ce dernier accompagné de sa femme et de son fils Jean).
Infirmières
Sept infirmières, et un aumônier, Yves Moreau de Montcheuil, 44 ans, philosophe et théologien très cultivé et très ouvert, qui avait participé activement à l’élaboration et à la diffusion des Cahiers du Témoignage chrétien, dénonçant l’antisémitisme et appelant les chrétiens à réveiller leur conscience, puis avait gagné le Vercors pour y assister les jeunes résistants et les blessés.
Cet endroit est sacré.
Drap
Un drap blanc est déployé près de l’entrée du porche : croit-on encore les nazis respectueux des conventions de Genève ? De la grotte, on entend passer les convois sur la route distante de 400 mètres.
Patrouilles
Les patrouilles allemandes qui ratissent le secteur s’approchent dangereusement du porche. Dans le ciel, le Storch, le mouchard, survole à très basse altitude l’hôpital improvisé.
Morts
- André Bourcereau, 26 ans décède le 25 juillet 1944
- Pierre Mallein, 18 ans, décédé le 24 juillet 1944
- Albert ou Auguste Mulheim, 24 ans, décédé 23 juillet 1944
- Henri Murot, décédé le 27 juillet 1944
- Édouard Ricordo, 27 ans,décédé le 23 juillet.
Trahison
Comment le refuge a-t-il été découvert ? Il n’est pas nécessaire de recourir à l’hypothèse de la trahison que rapporte souvent la mémoire collective.
Irruption
Le 27 juillet 1944, vers 16 heures, les soldats allemands font irruption à l’entrée du porche. Les quatre prisonniers de la Wehrmacht, reconnaissant des camarades de leur unité, leur crient de ne pas tirer, disant « ils nous ont soignés ».
Fraternisation
Devant un début de fraternisation de ses hommes, le chef du groupe les rappelle à l’ordre, jugeant que les quatre Polonais peuvent être des déserteurs. Il fait arracher leurs pansements pour vérifier si les blessures sont réelles, dans un bon Français, il requiert les responsables. Les docteurs Ganimède, Fischer, Ullmann s’avancent.
Allemands
Les Allemands font aligner médecins et infirmières face à la paroi, lever les blessés auxquels ils arrachent les pansements, et les dépouillent de tout ce qu’ils possèdent.
- Marc Liozon, 22 ans, résistant
- Guy Cretenet, 19 ans, résistant
- Armand Rosenthal, 43 ans, résistant
Agriculteur
Ils réquisitionnent un agriculteur de Saint-Agnan-en-Vercors, Jarrand, avec sa charrette tractée par des vaches, pour transporter douze grands blessés à Rousset où ils retrouveront les sept qui peuvent marcher ainsi que le personnel soignant.
Convoi
Le convoi des grands blessés rencontre un groupe de parachutistes allemands. La nuit tombe, le chef de ce groupe décide d’en finir.
Achever
Il fait remonter la charrette en direction de la grotte. En contrebas de celle-ci, sur un terre-plein, il fait achever les 14 grands blessés sur leur brancard :
- Marcel Amathieu, 32 ans
- Marcel Bahr, 25 ans, Polonais, sous-lieutenant
- René Cadillac, industriel de Romans, 36 ans
- André Charras, 22 ans, de Montvendre
- Jean Eymard, 21 ans, originaire de Rencurel (Isère)
- Roger Feneyrol, 18 ans, résistant de La Roche-de-Glun
- Roland Guerry, Charles Jean, 16 ans, résistant de Romans
- Jean (ou Charles ou Léon)
- Julien, 19 ans, résistant originaire de Lyon (Rhône)
- Joseph Locatelli, 21 ans, résistant originaire de Rencurel (Isère)
- Gabriel Moulin, 24 ans, résistant originaire d’Aubenas (Ardèche)
- Georges Roch, 18 ans, ouvrier en chaussures et résistant à Romans, où il avait été blessé par balle
- Jean Rouhaud, 23 ans, résistant originaire de Voiron (Isère), blessé le 21 juillet 1944 au col de La Croix-Perrin
- Paul Walpersvylers, 23 ans, résistant originaire de Méaudre (Isère)
Fosse
Tous seront enterrés le lendemain dans une fosse commune.
Colonne
L’autre colonne, en direction de Rousset, est arrêtée par un commandant autrichien. Ce dernier est injurié par Abdesselem Ben Ahmed, résistant originaire du Maroc, qui le traite de « sale boche », refusant de s’excuser, le maquisard est assommé à coups de crosse de mitraillette et pendu.
Rousset
Le lendemain 28 juillet 1944, au pont des Oules, en amont du hameau de Rousset, sept autres grands blessés sont achevés après avoir été contraints de creuser leur tombe :
- Albert Baigneux, 24 ans
- René Bourgund 17 ans, ouvrier, résistant de Romans
- Fernand Delvalle, 35 ans, blessé le 21 juillet 1944 à Vassieux ou au col de La Croix-Perrin
- Édouard Hervé, 24 ans, gendarme à La Chapelle-en-Vercors, grièvement blessé
- Roland Guerry, Vittorio Marinucci 18 ans, étudiant, réfugié lorrain, résistant de Romans
- Georges Robert, 20 ans, résistant originaire de Lyon
- (plus, selon certaines sources, un inconnu)
Grenoble
Les autres membres de ce groupe sont conduits à Grenoble et internés à la caserne de Bonne où siège la Gestapo.
Cvils
Les « civils », Jeanne Ganimède, son fils, et « Lilette » Lesage (dont les Allemands ignorent qu’elle est une résistante) peuvent s’échapper grâce à la complicité des Polonais de la Luire, le docteur Ganimède, autorisé à se rendre aux toilettes, réussit à s’évader.
Fusillés
Dans la nuit du 10 au 11 août 1944, au Polygone de Grenoble, sont fusillés les docteurs Fischer et Ullmann, et l’aumônier, le Père Yves Moreau de Montcheuil.
Exécuté
L’officier américain a la vie sauve. Par contre, le lieutenant Francis Billon, de la mission « Paquebot », originaire du Finistère, qui avait eu la cuisse brisée lors de son atterrissage à Vassieux, le 7 juillet 1944, est exécuté malgré son uniforme militaire de l’armée régulière française.
Infirmières
Les infirmières sont envoyées en camp de concentration. Odette Malossane y meurt le 25 mars 1945.
Exécutions
Les exécutions de la grotte de la Luire deviennent rapidement un symbole de l’atrocité de la répression allemande.
Résistance
Le maquis du Vercors fait partie des lieux de résistance emblématiques de la Seconde Guerre mondiale.
Cachés
Cachés dans le massif des Préalpes, les maquisards sont de jeunes hommes qui tentent de désorganiser l’Occupation allemande et de participer à la libération de la France.
Piège
Malgré leur énergie, ils ne parviennent pas à être correctement ravitaillés et sont pris au piège quand les Allemands les encerclent en juin et en juillet 1944.
Tragédie
Les combats sont une tragédie pour les maquisards et les habitants du massif qui recensent de lourdes pertes humaines.
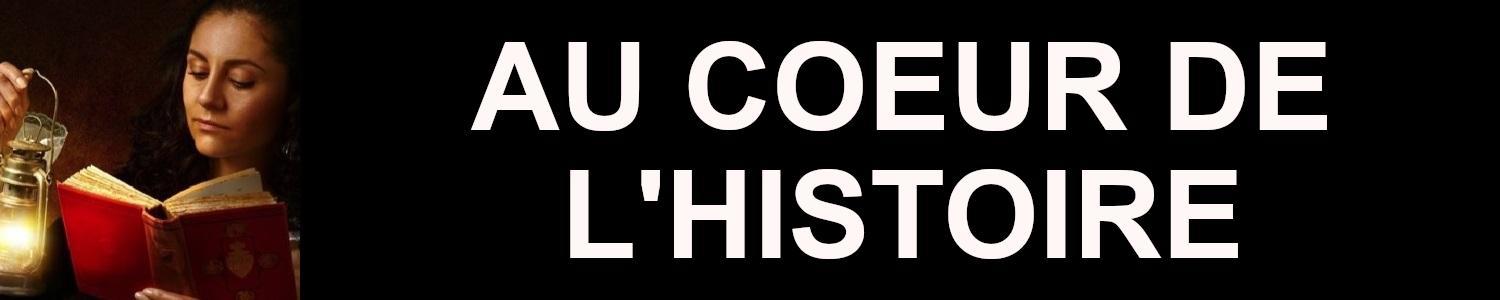
Commentaires
Enregistrer un commentaire