La naissance de la tour Eiffel
La naissance de la tour Eiffel
Construction de la tour Eiffel.
C’est à l’occasion de l’Exposition Universelle de 1889, date qui marquait le centenaire de la Révolution française qu’un grand concours est lancé dans le Journal officiel.
Premiers
Les premiers coups de pelle sont donnés le 26 janvier 1887. Le 31 mars 1889, la Tour achevée en un temps record, -2 ans, 2 mois et 5 jours s’impose comme une véritable prouesse technique.
Projet
Le projet d'une tour de 300 mètres est né à l'occasion de la préparation de l'Exposition universelle de 1889.
Concours
L'objet du concours lancé lors de l'exposition est « d'étudier la possibilité d’élever sur le Champ-de-Mars une tour de fer, à base carrée, de 125 mètres de côté et de 300 mètres de hauteur ».
Gustave Eiffel
Choisi parmi 107 projets, c’est celui de Gustave Eiffel, entrepreneur, Maurice Koechlin et Emile Nouguier, ingénieurs et Stephen Sauvestre, architecte qui est retenu.
Ingénieurs
Les deux principaux ingénieurs de l'entreprise Eiffel, Émile Nouguier et Maurice Koechlin, ont l'idée en juin 1884 d'une tour très haute.
Pylône
Conçue comme un grand pylône formé de quatre poutres en treillis écartées à la base et se rejoignant au sommet, liées entre elles par des poutres métalliques disposées à intervalles réguliers.
Extrapolation
C'est une extrapolation hardie à la hauteur de 300 mètres, soit l'équivalent du chiffre symbolique de 1000 pieds du principe des piles de ponts que l'entreprise maîtrise alors parfaitement.
Brevet
Eiffel prend le 18 septembre 1884 un brevet "pour une disposition nouvelle permettant de construire des piles et des pylônes métalliques d'une hauteur pouvant dépasser 300 mètres".
Projet
Pour rendre le projet plus acceptable par l'opinion publique, Nouguier et Koechlin demandent à l'architecte Stephen Sauvestre de mettre en forme le projet.
Le projet d'une tour de 300 mètres.
Version
Une première version bien différente, Sauvestre habille les pieds de socles en maçonnerie, relie les quatre grands montants et le premier étage par des arcs monumentaux, place de grandes salles vitrées aux étages, dessine un sommet en forme de bulbe, agrémente l'ensemble de divers ornements.
Simplifié
Le projet sera finalement simplifié, mais certains éléments comme les grandes arches de la base seront maintenus, contribuant à lui donner son aspect si caractéristique.
Résistance
La courbure des montants est mathématiquement déterminée pour offrir la meilleure résistance possible à l'effet du vent. Comme l'explique Eiffel : "Tout l'effort tranchant dû au vent passe ainsi dans l'intérieur des montants d'arête".
Tangentes
Les tangentes aux montants menées en des points situés à la même hauteur viennent toujours se rencontrer au point de passage de la résultante des actions que le vent exerce sur la partie de la pile au-dessus des deux points considérés.
Montants
"Les montants avant de se réunir à ce sommet si élevé, semblent jaillir du sol, et s'être en quelque sorte moulés sous l'action du vent".
La constuction.
Construction
Le montage des piles commence le 1er juillet 1887 pour s'achever vingt-et-un mois plus tard.
Usine
Tous les éléments sont préparés à l'usine de Levallois-Perret à côté de Paris, siège de l'entreprise Eiffel. Chacune des 18 000 pièces de la Tour est dessinée et calculée avant d'être tracée au dixième de millimètre et assemblée par éléments de cinq mètres environ.
Ouvriers
Sur le site, entre 150 et 300 ouvriers, encadrés par une équipe de vétérans des grands viaducs métalliques, s'occupent du montage de ce gigantesque meccano.
En 1930, des ouvriers jouent les équilibristes pour refaire une beauté au monument. AFP AFP.
Construction
Ce mode de construction est bien rodé à l'époque de la construction de la Tour. Les assemblages sont d'abord réalisés sur place par des boulons provisoires, remplacés au fur et à mesure par des rivets posés à chaud.
Rivet
En se refroidissant, ils se contractent, ce qui assure le serrage des pièces les unes avec les autres. Il faut une équipe de quatre hommes pour poser un rivet, un pour le chauffer, un pour le tenir en place, un pour former la tête, un dernier pour achever l'écrasement à coups de masse. un tiers seulement des 2 500 000 rivets que comprend la Tour ont été directement posés sur le site.
Fondations
Les piles reposent sur des fondations en béton installées à quelques mètres sous le niveau du sol sur une couche de gravier compact.
Arête
Chaque arête métallique dispose de son propre massif, lié aux autres par des murs, sur lequel elle exerce une pression de 3 à 4 kilos par centimètre carré.
Caissons
Côté Seine, on a employé des caissons métalliques étanches, où l'injection d'air comprimé permettait aux ouvriers de travailler sous le niveau de l'eau.
Échafaudages
La Tour est montée à l'aide d'échafaudages en bois et de petites grues à vapeur fixées sur la Tour elle-même.
Montage
Le montage du premier étage est réalisé à l'aide de douze échafaudages provisoires en bois de 30 mètres de hauteur, puis de quatre grands échafaudages de 45 mètres.
Charpente
Des "boîtes à sable" et des vérins hydrauliques remplacés après usage par des cales fixes permettent de régler la position de la charpente métallique au millimètre près.
Jonction
La jonction des grandes poutres du premier est ainsi réalisée le 7 décembre 1887. Les pièces sont hissées par des grues à vapeur qui grimpent en même temps que la Tour, en utilisant les glissières prévues pour les ascenseurs.
Construire
Il n'a fallu que cinq mois pour construire les fondations et vingt et un mois pour réaliser le montage de la partie métallique de la Tour.
Vitesse
C'est une vitesse record si l'on songe aux moyens rudimentaires de l'époque. Le montage de la Tour est une merveille de précision, comme s'accordent à le reconnaître tous les chroniqueurs de l'époque.
Chantier
Commencé en janvier 1887, le chantier s'achève le 31 mars 1889. Gustave Eiffel est décoré de la Légion d'honneur sur l'étroite plate-forme du sommet.
Émile Goudeau.
Émile Goudeau
Le journaliste Émile Goudeau visitant le chantier en décrit ainsi le spectacle "Une épaisse fumée de goudron et de houille prenait à la gorge, tandis qu'un bruit de ferraille rugissant sous le marteau nous assourdissait".
Perchés
Perchés sur une assise de quelques centimètres. On boulonnait encore par là ; des ouvriers, perchés sur une assise de quelques centimètres, frappaient à tour de rôle de leur massue en fer sur les boulons (en réalité les rivets).
Forgerons
On eût dit des forgerons tranquillement occupés à rythmer des mesures sur une enclume, dans quelques forges de village.
Étincelles
"Seulement ceux-ci ne tapaient point de haut en bas, verticalement, mais horizontalement, et comme à chaque coup des étincelles partaient en gerbes, ces hommes noirs, grandis par la perspective du plein ciel, avaient l'air de faucher des éclairs dans les nuées".
Polémiques
Débats et polémiques à l'époque de la construction. Avant même la fin de sa construction, la Tour était déjà au cœur des débats. Affublée de critiques par les grands noms du monde des lettres et des arts, la Tour a su s’imposer et rencontrer le succès qu’elle méritait.
Pamphlets
Après divers pamphlets ou articles publiés tout au long de l'année 1886, les travaux avaient à peine commencé que paraît, le 14 février 1887, la protestation des Artistes.
Protestation
Publiée dans le journal Le Temps, cette "Protestation contre la Tour de M. Eiffel" est adressée à M. Alphand, directeur des travaux de l'Exposition. Elle est signée de quelques grands noms du monde des lettres et des arts.
Noms
Charles Gounod, Guy de Maupassant, Alexandre Dumas fils, François Coppée, Leconte de Lisle, Sully Prudhomme, William Bouguereau, Ernest Meissonier, Victorien Sardou, Charles Garnier et d'autres que la postérité a moins favorisés.
Injures
D'autres pamphlétaires renchérissent sur cette violente diatribe, et les injures fusent : "ce lampadaire véritablement tragique" (Léon Bloy) ; "ce squelette de beffroi"(Paul Verlaine).
Difforme
"Ce mât de fer aux durs agrès, inachevé, confus, difforme" (François Coppée) ; "cette haute et maigre pyramide d'échelles de fer, squelette disgracieux et géant, dont la base semble faite pour porter un formidable monument de Cyclopes, et qui avorte en un ridicule et mince profil de cheminée d'usine" (Maupassant).
Suppositoire
"Un tuyau d'usine en construction, une carcasse qui attend d'être remplie par des pierres de taille ou des briques, ce grillage infundibuliforme, ce suppositoire criblé de trous" (Joris-Karl Huysmans).
Polémiques
Les polémiques s'éteindront d'elles-mêmes à l'achèvement de la Tour, devant la présence incontestable de l'œuvre achevée et face à l'immense succès populaire qu'elle rencontre. Elle reçoit deux millions de visiteurs pendant l'Exposition de 1889.
Protestation
"Nous venons, écrivains, peintres, sculpteurs, architectes, amateurs passionnés de la beauté jusqu'ici intacte de Paris, protester de toutes nos forces.
Indignation
De toute notre indignation, au nom du goût français méconnu, au nom de l'art et de l'histoire français menacés, contre l'érection, en plein cœur de notre capitale, de l'inutile et monstrueuse tour Eiffel, que la malignité publique, souvent empreinte de bon sens et d'esprit de justice, a déjà baptisée du nom de tour de Babel.
Enlaidir
La ville de Paris, va-t-elle donc s'associer plus longtemps aux baroques, aux mercantiles imaginations d'un constructeur de machines, pour s'enlaidir irréparablement et se déshonorer ?
Ridicule
Il suffit d'ailleurs, pour se rendre compte de ce que nous avançons, de se figurer un instant une tour vertigineusement ridicule.
Cheminée
Dominant Paris, ainsi qu'une noire et gigantesque cheminée d'usine, écrasant de sa masse barbare tous nos monuments humiliés, toutes nos architectures rapetissées, qui disparaîtront dans ce rêve stupéfiant.
Ombre
Et, pendant vingt ans, nous verrons s'allonger sur la ville entière, frémissante encore du génie de tant de siècles, nous verrons s'allonger comme une tache d'encre l'ombre odieuse de l'odieuse colonne de tôle "boulonnée".
Gustave Eiffel.
Réponse
Eiffel répond à la protestation des artistes dans une interview accordée au Temps le 14 février 1887 qui résume bien sa doctrine artistique :
Beauté
"Je crois, pour ma part, que la Tour aura sa beauté propre. Parce que nous sommes des ingénieurs, croit-on donc que la beauté ne nous préoccupe pas dans nos constructions et qu'en même temps que nous faisons solide et durable, nous ne nous efforçons pas de faire élégant ?
Harmonie
Est-ce que les véritables conditions de la force ne sont pas toujours conformes aux conditions secrètes de l'harmonie ? Or de quelle condition ai-je eu, avant tout, à tenir compte dans la Tour ? De la résistance au vent.
Force
Eh bien ! Je prétends que les courbes des quatre arêtes du monument, tel que le calcul les a fournies donneront une grande impression de force et de beauté.
Hardiesse
Elles traduiront aux yeux la hardiesse de la conception dans son ensemble, de même que les nombreux vides ménagés dans les éléments mêmes de la construction accuseront fortement le constant souci de ne pas livrer inutilement aux violences des ouragans des surfaces dangereuses pour la stabilité de l'édifice.
Colossal
"Il y a, du reste, dans le colossal une attraction, un charme propre, auxquelles les théories d'art ordinaires ne sont guère applicables".
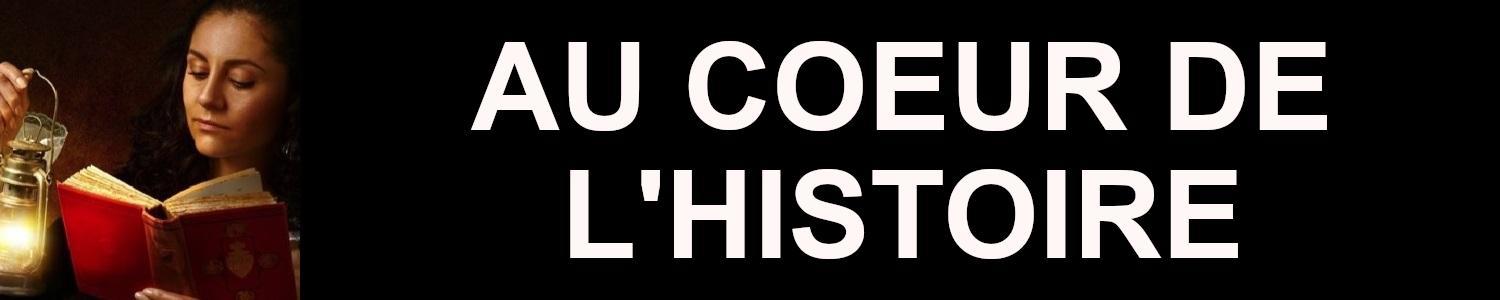
Commentaires
Enregistrer un commentaire