Cardinal de Richelieu : la biographie du ministre de Louis XIII
Cardinal de Richelieu : la biographie du ministre de Louis XIII
Le cardinal de Richelieu,
Prélat et homme d'Etat français, le principal ministre de Louis XIII a renforcé le pouvoir royal et fondé l'Académie française. Retour sur son parcours mouvementé.
Armand Jean du Plessis
Le cardinal de Richelieu, de son vrai nom Armand Jean du Plessis, est né le 9 septembre 1585 à Paris et mort le 4 décembre 1642 à Paris.
Figure
Il fut une figure d'autorité importante de la monarchie du XVIIe siècle aux côtés du roi Louis XIII. Auprès du monarque, le cardinal de Richelieu fut "principal ministre d'État" et considéré comme l'homme fort des réformes opérées au milieu du XVIIe siècle.
Diplomate
Fin diplomate, homme intransigeant favorable à une monarchie forte et absolue, il s'imposa à la tête du pouvoir en justifiant ses décisions les plus impopulaires par la raison d'Etat.
Guerres
Il mena de front les guerres contre les Habsbourg, réprima d'une main de fer les révoltes paysannes et étouffa les velléités de la noblesse, mais aussi des protestants dans le pays.
Armand Jean
Armand Jean est le quatrième d'une famille de six enfants, famille d'ancienne noblesse de robe et d'épée mais pauvre, d'origine poitevine et parisienne.
Père
Son père, François du Plessis, seigneur de Richelieu, est le grand prévôt de France et sa mère, Suzanne de La Porte, est fille d'avocat au Parlement.
Fièvre
Il perd son père jeune, en 1590, d'une fièvre pernicieuse (une forme grave de paludisme) mais la générosité financière royale lui permet de bien vivre, en septembre 1594, son oncle Amador de La Porte l'envoie au collège de Navarre pour étudier la philosophie.
Formation
Puis il reçoit une formation par Monsieur de Pluvinel à l'académie équestre où il a accès à tout un tas d'enseignement comme la danse, l'escrime, la littérature... Dans le but d'effectuer une carrière militaire.
Frère
C'est grâce à son frère, Alphonse-Louis du Plessis, qu'il se tourne vers une carrière religieuse. En effet, son frère refuse l'évêché de Luçon, donné à la famille par le roi Henri III en 1584, préférant une plus vie plus austère parmi les moines de la Grande Chartreuse.
Études
Ainsi, attiré par la perspective de devenir évêque, il commence des études de théologie en 1605 et obtient en 1607 son doctorat à la Sorbonne.
Évêque
Le 18 décembre 1606, il est donc nommé évêque de Luçon par le roi Henri IV et le 17 avril 1607, il obtient, du cardinal de Givry, l'investiture canonique. Sans être un pieu fervent, il fut tout de même un évêque attaché à ses devoirs.
Réformateur
Il fait d'ailleurs figure de réformateur catholique, notamment pour avoir mis en place les réformes institutionnelles que le Concile de Trente avait instaurées entre 1545 et 1563, devenant, de fait, le premier évêque de France à les exécuter.
Richelieu
Richelieu commence sa carrière politique en étant élu député du clergé poitevin, aux états généraux de Paris, en août 1614, puis il devient dans le même temps porte-parole de l'assemblée.
Marie de Médicis
Il est ensuite au service de Marie de Médicis. Épouse du roi Henri IV, elle devient régente suite à l'assassinat du roi, le 14 mai 1610, par François Ravaillac de coups de poignard.
Fils
Son fils Louis XIII, alors âgé de 9 ans, étant trop jeune pour gouverner, elle devient régente. En novembre 1615, elle fait de Richelieu le Grand Aumônier de la jeune reine Anne d'Autriche.
Concino Concini
Concino Concini, époux de la dame d'atours de Marie de Médicis et favori de la régente, possède une grande influence politique.
Nommé
Le 25 novembre 1616, il nomme Richelieu ministre des Affaires étrangères au Conseil du roi. Mais Louis XIII se trouve dans l'ombre de Concini.
Pouvoir
Pour appuyer son pouvoir, il décide donc de le faire assassiner, le 24 avril 1617 et devient ainsi roi. Richelieu et Marie de Médicis ne sont pas en bons termes avec Louis XIII : celui-ci trouve que sa mère monopolise le pouvoir et que Richelieu exerce une emprise tyrannique sur lui.
Exil
La mère de Louis XIII et Richelieu partent donc en exil. Au château de Blois.
Efforts
À force d'efforts et de diplomatie, Richelieu parvient à réconcilier le roi et sa mère, d'abord par le traité d'Angoulême le 30 avril 1619, où Louis XIII cède les villes d'Angers, de Chinon et des Ponts-de-Cé à la reine-mère.
Conseil
Cependant, celle-ci ne peut plus revenir au Conseil. Insatisfaite, Marie de Médicis relance les hostilités.
Réconciliation
Le 10 août 1620, Richelieu organise une nouvelle réconciliation, avec le traité d'Angers où le monarque autorise cette fois-ci le retour de Marie de Médicis à la cour du roi, le cardinal de Richelieu obtient grâce à cela une réputation de bon négociateur.
Intronisé
Le 12 décembre 1622, il est intronisé cardinal à Lyon par le pape Grégoire XV, grâce à Marie de Médicis. Celle-ci conseille également à son fils, Louis XIII, d'avoir Richelieu à ses côtés.
Roi
Mais le roi ne lui fait toujours pas confiance. Le cardinal de Richelieu n'entre donc de nouveau au Conseil du roi que le 29 avril 1624.
Louis XIII.
Position
Grâce à sa nouvelle position, le pouvoir de Richelieu s'accroît, notamment après qu'il a gagné la confiance de Louis XIII.
Programme
Il lui propose donc un programme qui possède trois lignes directrices : la déchéance des protestants, de la noblesse et de la maison des Habsbourg.
Lutte
Richelieu lutte vigoureusement contre le protestantisme et il va s'occuper en particulier de la ville de La Rochelle, cette commune est le bastion du protestantisme, elle est en relation avec les Provinces-Unies des Pays-Bas, qui sont calvinistes, et l'Angleterre.
Cités
Grâce à l'édit de Nantes, les cités protestantes se sont transformés en "Etat dans l'Etat", Richelieu y voit donc une menace pour le pouvoir royal.
Indépendance
En effet, en mai 1621, La Rochelle proclame son indépendance et l'établissement d'une constitution de la "Nouvelle République de La Rochelle".
Louis XIII
Le mois suivant, Louis XIII demande au Duc d'Epernon de faire le siège de la ville puis il confie le commandement militaire au cardinal de Richelieu. le 12 juillet 1627, l'île de Ré voit le débarquement des Anglais sur leur terre.
Siège
Richelieu débute donc le siège de la ville, fait fortifier les îles de Ré et d'Oléron et coupe toutes les voies de communication terrestres.
Ravitaillement
Pour empêcher le ravitaillement par la mer, Richelieu fait également construire une digue. Les secours anglais ne tardent pas, mais ils échouent par trois fois, entraînant leur retrait et contraignant la ville, qui subit la famine, à capituler sans condition le 28 octobre 1628.
Survivants
Il ne reste plus que 5 400 survivants sur 28 000 habitants. Louis XIII leur accorde son pardon puis conclut la paix d'Alès le 28 juin 1629, supprimant leurs privilèges et les places de sûreté protestantes, mais laissant aux protestants la liberté de culte établie par l'édit de Nantes.
Proposition
Par sa dernière proposition, celle de la déchéance de la maison des Habsbourg, la relation du cardinal de Richelieu avec Marie de Médicis est altérée, le cardinal de Richelieu scelle ensuite la fin de ce lien en la trahissant par ce qu'on appelle "la journée des Dupes".
Journée
Cette journée se produit les dimanches 10 et lundi 11 novembre 1630. Le roi Louis XIII doit renforcer sa position et son pouvoir de souverain dans son royaume et pour cela évincer ses adversaires politiques.
Marie de Médicis
Mais Marie de Médicis n'est pas en accord avec la politique de Richelieu qui concerne les Habsbourg, elle demande donc à son fils de destituer le cardinal.
Confiance
Lui ayant accordé pleinement sa confiance, il préfère garder Richelieu à ses côtés. Il en résulte donc, après plusieurs bras de fer, l'exil de sa mère Marie de Médicis à Compiègne.
Triple portrait du cardinal de Richelieu, par Philippe de Champaigne (Londres, National Gallery, vers 1642).
Académie
Inspiré d'un groupe littéraire appelé le "cercle Conrart", initié par Valentin Conrart, en 1629, le cardinal de Richelieu crée l'Académie française le 29 janvier 1635, par lettres patentes signées de la main du roi.
Mission
La mission de l'Académie est d'harmoniser la langue française et de la rendre compréhensible pour tous.
Statuts
De plus, dans ses statuts, l'article 24 ajoute que "la principale fonction de l'Académie sera de travailler avec tout le soin et toute la diligence possible à donner des règles certaines à notre langue et à la rendre pure, éloquente et capable de traiter les arts et les sciences".
Autorité
Sous autorité royale, elle fut longtemps sous son influence.
Mort
Dans les dernières années de sa vie, Richelieu souffre de plusieurs maladies - tuberculose intestinale, ténesme, fièvres récurrentes, rhumatismes, goutte, migraine. Il décède le 4 décembre 1642, d'une probable tuberculose pulmonaire.
Impopulaire
À cause de ses exigences politiques, il fut tellement impopulaire que le peuple aurait allumé des feux de joie à l'annonce de sa mort. Le cardinal Mazarin prendra sa suite comme ministre et homme de pouvoir.
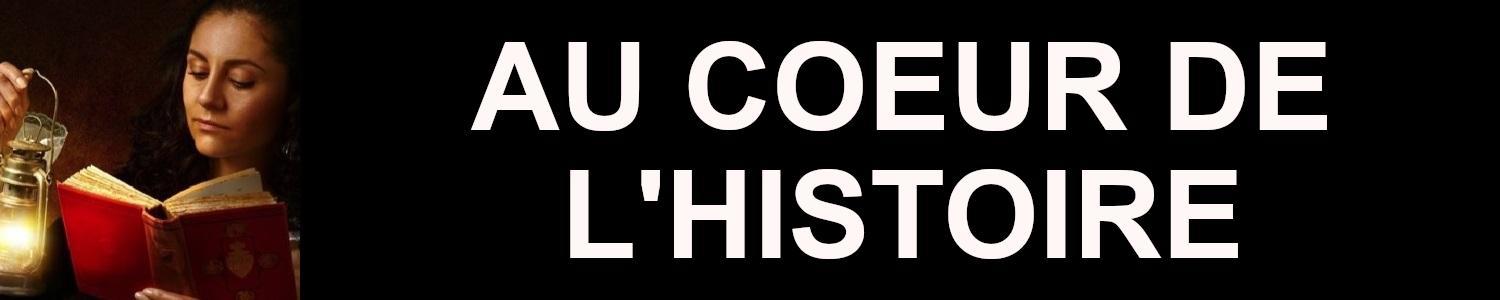
Commentaires
Enregistrer un commentaire